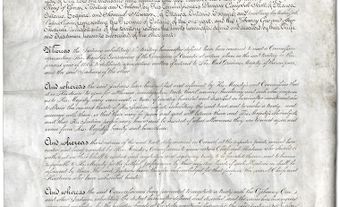Le Traité n° 11 est le dernier des traités numérotés conclus entre les Premières nations et le gouvernement canadien le 22 août 1921 après la Confédération, alors que le pays étend ses frontières au nord et à l’ouest. Il couvre plus de 950 000 km2, correspondant aujourd’hui en partie au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Les Premières nations impliquées sont principalement Dénés, et comprennent les Gwich'ins, Tlichos (Dogribs) et Sahtus. Tout comme avec les autres traités numérotés, le gouvernement ne souhaite rien conclure sans servir ses intérêts. Le Traité n° 11 ne voit donc le jour qu’en 1921, après la découverte de réserves pétrolières et gazières dans la région du Mackenzie. Toutefois, des négociations hâtives, doublées d’une faible mise en œuvre des conditions, notamment en ce qui concerne les réserves et les revendications territoriales, mènent à des désaccords considérables entre les parties sur l’esprit du traité et la nature des promesses non tenues. En conséquence, un grand nombre de signataires du Traité n° 11 se sont également engagés dans le processus des traités modernes (voir Traités autochtones).
Contexte historique
La Proclamation royale de 1763 définit le concept de titre autochtone, en vertu duquel les peuples autochtones ont le droit d’utiliser et d’occuper les terres qu’ils habitent. Le gouvernement canadien se retrouve donc théoriquement dans l’obligation de conclure des traités avec les peuples autochtones avant la colonisation ou l’utilisation de ces terres. À la suite de l’acquisition de la Terre de Rupert de la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) en 1870, le gouvernement met en œuvre un ambitieux projet de conclusion de traités afin de faire révoquer le titre le long de la ceinture fertile de l’Ouest canadien, l’objet de ses visées de colonisation. Les traités sont également nécessaires en prévision de la construction d’infrastructures, comme le Chemin de fer Canadien Pacifique devant relier l’est et l’ouest du pays, traversant au passage divers territoires autochtones.
En revanche, le gouvernement n’a aucun intérêt à conclure des traités visant des régions n’ayant en apparence aucune utilité pour la colonisation et le développement industriel, et cela est particulièrement vrai dans le Nord. Le gouvernement ne souhaite pas assumer le fardeau financier et administratif découlant de la conclusion de traités dans cette région du pays. De nombreux fonctionnaires sont également d’avis qu’en dépit de l’engagement explicite du gouvernement envers l’assimilation des « Indiens», les peuples autochtones s’en sortent généralement mieux en maintenant des modes de vie traditionnels. Le gouvernement maintient cette position en dépit des preuves d’extrême pauvreté et des demandes répétées de missionnaires, de la CBH et de certaines Premières nations de conclure des traités dans les régions non couvertes et d’élargir les avantages découlant de ces traités. Bien que le gouvernement ait fourni l’aide aux peuples autochtones du Nord par le truchement de la CBH, il apparaît évident que les négociations de traités ne sont amorcées que lorsqu’il en tire des avantages. La ruée vers l’or du Klondike de la fin des années 1890 constitue la bougie d’allumage à ce chapitre, car elle entraîne l’ouverture du Nord, région couverte par le Traité n° 8 conclu en 1899 et le Traité n° 10 de 1906-1907.
De même, le Traité n° 11 est issu d’une nécessité politique et économique. Bien que l’existence d’importants gisements pétroliers dans la région du Mackenzie soit connue depuis la fin des années 1880, le forage exploratoire se répand dans les décennies qui suivent, et la découverte d’un puits à Norman Wells au cours de l’été de 1920 est à l’origine d’une ruée d’exploration. Au moins un journal canadien déclare qu’il s’agit du « plus grand gisement de pétrole au monde »; la Calgary Gazette avance quant à elle que ce gisement couvre plus de 600 milles (environ 965 kilomètres) d’est en ouest. Les politiciens se mettent alors immédiatement à discuter de la meilleure manière d’exploiter cette ressource, en dépit du fait que la terre sous laquelle elle repose n’a pas été cédée.
En 1920, Henry Anthony Conroy, qui a pris part aux négociations du Traité n° 8 et qui pendant des années préconise l’extension de la portée du traité au reste du Nord, écrit au surintendant général adjoint des Affaires indiennes Duncan Campbell Scott pour lui faire part de sa volonté de voir se conclure un nouveau traité :
Le titre autochtone n’est pas encore éteint par rapport à l’ensemble des terres au nord du Grand lac des Esclaves, et à mon avis il serait souhaitable de faire céder ce territoire par les chefs du Nord le plus tôt possible afin d’éviter toute complication par rapport à l’exploitation pétrolière du pays […] Au cours des dernières années, j’ai recommandé ce plan d’action, mais puisqu’il n’y avait pas d’afflux de Blancs dans cette région, la question a été laissée en suspens.
L’avis d’Henry Anthony Conroy revêt une nouvelle importance après la découverte du puits de Norman Wells, et la conclusion d’un traité devient soudainement plus pressante. Comme le décrit le surintendant général adjoint dans une lettre au ministre de l’Intérieur, James Lougheed, en novembre de la même année, « l’exploitation rapide et inattendue du pays, la création d’industries pétrolières et l’immigration croissante » font en sorte que la conclusion de traités est une question urgente. « Les Indiens eux-mêmes sont très désireux d’en conclure », ajoute-t-il.
Conditions du traité
Comme pour les autres traités numérotés, le Traité n° 11 propose de l’argent, des provisions, des réserves et d’autres garanties en échange de terres. Les conditions énoncées dans le Traité n° 11 sont toutefois plus vagues que celles des autres, en particulier en ce qui concerne l’agriculture et l’éducation. Cela donne à penser que le gouvernement ne s’attend pas nécessairement à ce que les signataires adoptent un mode de vie sédentaire.
Le territoire des réserves doit être déterminé en fonction d’une superficie d’un mille carré par famille de cinq, plus ou moins de terre étant attribuée en fonction de la taille de chaque famille. Le gouvernement peut également se servir d’une partie de ces réserves pour des travaux publics comme la construction de routes, moyennant compensation. Les signataires ont le droit de chasser, de pêcher et de piéger, sous réserve de la réglementation gouvernementale et de la nécessité d’employer les terres visées pour la colonisation ou le développement.
À la suite de l’établissement des réserves, chaque groupe doit recevoir dix haches, cinq scies à main, cinq tarières et une meule, ainsi que des limes et des pierres à aiguiser afin de maintenir leur équipement affûté. Chaque groupe doit également recevoir de l’équipement de pêche, de piégeage et de chasse, d’une valeur de 50 $ par famille. En outre, chaque année ils ont droit à de la ficelle, des munitions et d’autres provisions nécessaires, jusqu’à concurrence de trois dollars. Pour quiconque souhaitant se mettre à l’agriculture, le gouvernement consent à apporter l’« aide jugée nécessaire à cette fin ».
Comme paiement forfaitaire, chaque chef a droit à 32 $, tandis que les notables et tous les autres ont respectivement droit à 22 $ et à 12 $. Chaque année qui suit, chaque chef doit recevoir 25 $, chaque notable, 15 $, et toute autre personne, 5 $. Le chef se voit attribuer une médaille d’argent commémorant le traité, un drapeau et une copie papier du traité. Les chefs et les notables ont de plus droit à de nouveaux vêtements tous les trois ans.
En matière d’éducation, le gouvernement accepte « de payer le salaire d’enseignants pour instruire les enfants desdits Indiens de la manière jugée opportune par le gouvernement de Sa Majesté ».
Négociations et signatures, 1921

Henry Conroy est nommé commissaire du traité. Il se met en route à l’été 1921 en compagnie de l’évêque catholique Gabriel Breynat, surnommé l’« évêque volant » en raison de ses années de services religieux auprès des habitants grandement dispersés de la région du Mackenzie. Des préavis ont alors déjà été envoyés, indiquant les dates et les emplacements des réunions de traité (et de la Commission des Sang-Mêlé, car comme dans des cas précédents, les revendications des Métis et celles des Premières nations seraient résolues en même temps).
Avant leur départ, Gabriel Breynat et Henry Conroy se rendent à une rencontre au Département des pêches pour demander d’obtenir une clause dans le traité qui garantirait des droits de pêche aux membres des Premières nations. Ils se heurtent à une rebuffade, se faisant au passage rappeler qu’ils « doivent être guidés par les conditions énoncées [dans le traité] et […] doivent s’abstenir de faire quelque autre promesse que ce soit aux Indiens ». Plutôt que de négocier, Henry Conroy a pour principale tâche d’obtenir un accord aux conditions prédéterminées. Comme Gabriel Breynat le fait remarquer plus tard : « La Commission royale est arrivée d’Ottawa pour négocier les conditions d’un traité avec eux, lesquelles conditions avaient été préparées pour leur être imposées plutôt que pour être librement envisagées dans un esprit de réconciliation et de concessions mutuelles, comme cela est d’usage lors de la négociation de traités ».
Une autre difficulté provient du fait que, dans le cadre du processus de traité, les groupes doivent élire un chef auquel incombe la tâche de conclure le traité au nom de son peuple. Cependant, le concept de « chef » est en grande partie étranger à de nombreux peuples autochtones du Nord, tout comme l’idée de conférer à une seule personne le pouvoir de prendre des décisions au nom de tous. Les chefs sont donc parfois sélectionnés au hasard ou selon un raisonnement douteux, et cela se répercute sur le processus de négociation.
Le groupe du traité effectue son premier arrêt le 24 juin 1921 à Fort Providence, Gabriel Breynat arrivant de Fort Smith. La plupart des participants y sont alors déjà rassemblés en prévision des négociations. Un homme dénommé Paul Lefoin est unanimement choisi comme chef, en raison de sa générosité et de ses talents de chasseur. Selon des témoins issus des Premières nations, Paul Lefoin se montre peu disposé à conclure un traité, ayant entendu dire que les Cris, au Sud, ont été parqués dans des réserves tout en se voyant empêchés de chasser. Il aurait refusé de toucher le crayon pour donner son assentiment jusqu’à ce que la liberté de chasser, de pêcher et de piéger comme d’habitude soit garantie. Cette garantie est bel et bien donnée et les négociations se concluent, bien qu’il soit possible qu’il n’ait pas signé physiquement le document. Un groupe de Trout Lake arrive deux jours plus tard et signe son adhésion au traité.
La commission se rend ensuite à Fort Simpson, où elle doit répondre à de nouvelles questions touchant aux droits de chasse. Dans l’entrée du 8 juillet, le journal de la mission catholique indique énigmatiquement que les « Indiens n’ont aucun désir d’accepter le traité ». Toutefois, trois jours plus tard, on y indique que « le dernier des Indiens a accepté le traité ». Il est probable que Gabriel Breynat est celui qui parvient à les convaincre : il prétend être « responsable de la signature du traité à plusieurs endroits, notamment à Fort Simpson », cette localité ayant une importante population catholique. Cependant, la procédure illustre également un problème avec les chefs élus. Certains témoins avancent que le chef initialement choisi pour négocier, Johnny Norwegian [Korwergen], ne voulant pas signer, le vieil Antoine [Nakekon] le remplace lorsque celui-ci va dîner. En l’absence du premier, le second accepte les conditions.
Le 12 juillet, la commission quitte Fort Simpson en direction de Fort Wrigley. Le porte-parole habituel des Autochtones locaux ne souhaite toutefois pas être impliqué dans le traité. Julian Yendo, qui est inscrit sur le traité en tant que signataire principal, mais qui est absent à la plupart des négociations, déclare : « J’avais trois oncles. Ceux-ci se sont mis à se parler, puis m’ont pointé. Je suis ainsi devenu chef, et les autres, plutôt craintifs, ne s’y sont pas opposés. »
La confusion règne alors. Un autre témoin indique que, bien qu’ils ne comprennent pas la raison d’être du traité, la présence de Gabriel Breynat les rassure : « Nous avions confiance en lui, en sa qualité de garant des paroles de Dieu ».
Le groupe met ensuite le cap sur Fort Norman, à proximité du lieu de découverte du pétrole. Les deux tiers des personnes s’y trouvent. Les autres, partis à la chasse, ont apparemment indiqué qu’ils accepteront le traité. Henry Conroy promet à ceux qui sont restés que rien ne changera et que l’argent est une sorte de cadeau. À nouveau, Gabriel Breynat contribue à rassurer la communauté principalement catholique que le gouvernement est bien intentionné.
Le 19 juillet, la commission arrive à Fort Good Hope, où elle obtient rapidement un accord au traité. Arrivée cinq jours plus tard à la rivière Arctic Red, elle parvient à conclure les négociations le jour même.
Gabriel Breynat ne se rend pas à Fort McPherson, sa population étant anglicane. Henry Conroy se rend compte que beaucoup de personnes sont parties à la pêche, mais tente tout de même de persuader le reste que leur capacité à maintenir un mode de vie traditionnel ne sera pas affectée. Il y parvient, et le groupe se met en chemin jusqu’à son dernier arrêt : Fort Rae, qui, avec 800 personnes, constitue la plus grande localité des Premières nations aux Territoires du Nord-Ouest.
Selon des comptes rendus des Tlichos, d’emblée leur chef Monfwi ne voit pas le traité d’un bon œil. D’autres Tlichos ayant signé un traité antérieur à Fort Resolution sont vexés par des promesses non tenues : des chasseurs et trappeurs blancs empiètent sur leurs terres, tandis que les lois sur la chasse au gibier, desquelles ils devaient être exemptés, sont appliquées. En fin de compte, Monfwi sert un ultimatum : il désigne les limites des terres pour son peuple sur un bout de papier, circonscrivant une zone dans laquelle leurs libertés ne seront jamais restreintes, et exige une garantie que cela sera maintenu. Gabriel Breynat lui promet que ce sera le cas, et appose sa signature sur le bout de papier comme gage de sa promesse. Le traité est ensuite signé, et Monfwi garde une copie de la carte et du traité. Ces deux éléments se perdent toutefois par la suite.
Le groupe est de retour à Edmonton le 11 septembre, ayant signé le traité à tous les arrêts requis, exception faite de Fort Liard. L’année suivante, l’agent des Affaires indiennes Thomas William Harris est autorisé en tant que commissaire à s’y rendre pour obtenir l’adhésion au traité, Henry Conroy étant décédé au printemps. Alors que les négociations avancent rapidement et se concluent en un jour, les conditions ne sont probablement pas exposées clairement. Par exemple, près de cinquante ans après la conclusion du traité, un homme Acho Dene Koe qui était présent, Baptiste Dudan, ignore toujours la raison pour laquelle il reçoit annuellement cinq dollars du gouvernement.
Implications et interprétations
En général, les négociations sont caractérisées par la hâte et le désir de persuader les gens que le traité est dans leur intérêt. Il y a certainement lieu de se demander si les conditions ont été expliquées clairement et suffisamment en détail; Victor Lafferty, le traducteur à Fort Providence, affirmera plus tard qu’il n’a « lu ni traduit aucun bout de papier ni quoi que ce soit par écrit ». Même ceux qui s’expriment en anglais sont généralement analphabètes. Une confusion compréhensible règne donc relativement à l’interprétation et à l’application du traité. L’évêque Gabriel Breynat soutient plus tard qu’Henry Conroy a effectivement fait des promesses verbales concernant les droits des signataires de poursuivre leur mode de vie traditionnel, et qu’il s’attendait à ce que ces promesses trouvent écho dans la version écrite définitive du traité. Cela n’a pas été le cas, et en mourant, Henry Conroy a emporté ses promesses avec lui.
En ce qui concerne les bienfaits, le traité n’apporte que très peu des changements positifs espérés par les Premières nations qui le signent. Alors que les traitements médicaux restent en grande partie inaccessibles, une épidémie de grippe, doublée de cas de tuberculose et de pneumonie, dévaste les collectivités du Nord dans les années qui suivent. Les écoles missionnaires demeurent la seule option pour l’éducation pendant les deux décennies subséquentes. Pendant ce temps, les Premières nations continuent à faire face à la concurrence croissante des trappeurs blancs, qui épuisent les stocks d’animaux à fourrure de façon si importante que de nouveaux règlements de chasse au gibier deviennent nécessaires.
Comme dans de nombreux autres traités, il semble peu probable que les signataires soient conscients que le traité implique la cession de terres, ni même ce que pareille cession entraînerait. En 1959, la Commission Nelson est mise sur pied pour enquêter sur les dispositions non tenues des Traités 8 et 11. Entre autres choses, elle constate que les concepts autochtones de la propriété des terres ont très peu changé et qu’« il [est] impossible de faire comprendre aux Indiens qu’il est possible de séparer les droits miniers de la propriété réelle des terres ». (Voir Territoire autochtone).
En 1973, le juge William Morrow de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest rend une décision selon laquelle la Fraternité des Indiens (depuis renommée Nation dénée) pourrait déposer une réclamation couvrant plus d’un million de kilomètres carrés, en grande partie sur la base du témoignage d’anciens mettant en lumière la manière dont les traités étaient perçus comme des accords de paix et d’amitié, et non pas comme la cession des terres. Bien qu’elle ait ensuite été annulée, cette décision établit le fondement du processus moderne des revendications dans le Nord. En 1976 s’amorcent les négociations entre la Nation dénée, le gouvernement du Canada et l’Association des Métis. Ces développements se produisent au beau milieu de l’enquête Berger, visant à déterminer si le pipeline de la vallée du Mackenzie doit être construit, en dépit des revendications territoriales non résolues et des protestations des populations autochtones.
Depuis, le Nord a été le théâtre de nombreuses revendications territoriales globales, entraînant notamment des accords avec les Gwich'ins, Tlichos et Inuvialuits. Beaucoup d’autres sont en cours. Cependant, comme le juge Thomas Berger le remarque avec prescience dans son rapport, « le règlement des revendications autochtones n’est pas qu’une simple transaction… Il serait donc faux de penser que la signature d’un bout de papier résout la question une bonne fois pour toutes. »

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom