L’opposition à la Confédération existe depuis qu’une union des colonies d’Amérique du Nord britannique a été proposée pour la première fois à la fin des années 1840. Dans les parties de l’est du pays, les opposants craignaient généralement que la Confédération ne retire le pouvoir aux provinces et le remette au gouvernement fédéral, ou que l’union mène à des impôts plus élevés et à une conscription militaire. Plusieurs de ces opposants ont finalement abandonné et ont même travaillé pour le gouvernement canadien. Dans l’ouest, on n’a jamais demandé aux peuples autochtones de la colonie de la rivière Rouge s’ils voulaient se joindre à la Confédération. Craignant pour leur culture et leurs droits fonciers sous le contrôle canadien, ils ont organisé une insurrection de cinq mois contre le gouvernement. Plusieurs nationalistes québécois ont longtemps cherché à se séparer de la Confédération, soit avec les mesures extrêmes du Front de libération du Québec (FLQ), ou soit avec les référendums de 1980 et 1995.

Les frères Dorion de l’est du Canada
Alors que l’Europe est en proie à de nombreuses révolutions en 1848, un groupe de jeunes francophones radicaux du Québec crée le Parti rouge (également connu comme étant le Parti démocratique). Le parti veut abroger l’Acte d’Union qui a fusionné le Haut et le Bas-Canada (renommés Canada-Ouest et Canada-Est) en une seule colonie. Il veut également que la nouvelle Province du Canada soit annexée par les États-Unis (voir Association pour l’annexion). Les dirigeants du mouvement demandent que tous les fonctionnaires du gouvernement soient élus, ils demandent également l’expansion du droit de vote, et la fin du système seigneurial qui est détesté (un système féodal de partage des terres qui force 80 % de la population à dépendre personnellement au seigneur local).
Les frères Dorion forment un duo puissant au sein du parti. Jean-Baptiste-Éric Dorion, le cadet, s’emporte souvent face à ses adversaires ; ils le surnomment l’enfant terrible. Son éducation formelle ne dépasse pas l’école primaire, mais il lit énormément. En 1844, il commence à travailler comme journaliste et activiste politique. En 1847, il devient le cofondateur de L’Avenir, un journal qui fait avancer la cause du Parti rouge.
Jean-Baptiste-Éric Dorion croit que la grande union des colonies d’Amérique du Nord britannique, une idée alors envisagée, serait un échec.
« Je m’oppose à la Confédération parce que j’entrevois d’innombrables difficultés au sujet des pouvoirs communs accordés aux gouvernements locaux et généraux dans plusieurs domaines », affirme-t-il. « Ces conflits seront toujours résolus au profit du gouvernement général et au détriment des revendications souvent légitimes des Provinces ».
Antoine-Aimé Dorion, son aîné de huit ans, adopte une approche plus tempérée. Avocat, il devient chef du Parti rouge en 1854. Il occupe un siège à l’Assemblée législative de la Province du Canada. Il fait l’éloge des structures politiques américaines, soutient les idées libérales et s’oppose à la mainmise de l’Église catholique sur la vie publique, les affaires et la finance.
Il partage le désir de son frère d’empêcher l’établissement de la Confédération. Il croit également qu’elle aurait pour effet de détourner le pouvoir des provinces au gouvernement fédéral.
Mais la Confédération reporte leurs objections. Jean-Baptiste-Éric Dorion n’en sera jamais témoin ; il meurt en 1866 à l’âge de 40 ans. Antoine-Aimé Dorion assiste en 1864 à la Conférence de Québec et dénonce la Confédération. Cependant, lorsque celle-ci devient réalité, il change de position et devient procureur général et ministre de la Justice du nouveau pays.
Le Parti politique des frères Dorion suit la voie d’acceptation de l’aîné après la Confédération. Il fusionne avec Clear Grits du Canada-Ouest pour former le Parti libéral.
Joseph Howe en Nouvelle-Écosse
La Nouvelle-Écosse prospère en tant que colonie britannique. Elle a un sens sain d’indépendance et d’industrie qui remonte au début des années 1700. L’idée de risquer cette prospérité pour fusionner avec d’autres colonies semble, pour plusieurs de ses habitants, être une très mauvaise idée. Né à Halifax, Joseph Howe utilise ses superbes talents de discours publics et d’écriture afin de tenter d’empêcher la Nouvelle-Écosse de se joindre à la Confédération.
Joseph Howe dirige le Novascotian, le journal le plus lu de la province. Il se retrouve devant le tribunal, accusé de diffamation criminelle en 1835. Son journal ayant critiqué des responsables gouvernementaux, ceux-ci veulent le faire payer. Il est acquitté, mais il quitte la salle d’audience avec une profonde méfiance du gouvernement.
Joseph Howe mène ensuite la lutte pour obtenir l’établissement d’un gouvernement responsable en Nouvelle-Écosse, en 1848 (voir La Nouvelle-Écosse, berceau de la démocratie parlementaire canadienne). Ceci renforce sa conviction que le meilleur avenir de la colonie repose sur l’indépendance. Il note fièrement que la colonie a gagné l’établissement d’un gouvernement responsable sans « qu’un coup soit porté ou qu’une vitre soit brisée ».
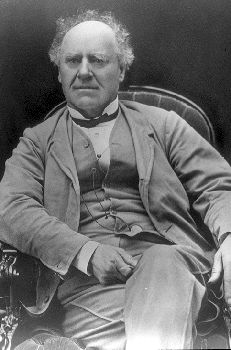
Les Néo-Écossais élisent Joseph Howe au poste de premier ministre en 1860. Une fois au pouvoir, il soutient qu’il incombe à ses électeurs de décider si la Nouvelle-Écosse doit se joindre à la Confédération. Il compare la proposition de Confédération à une union entre l’Écosse et la Pologne, faisant ainsi étant du fait que les intérêts de la Nouvelle-Écosse ne correspondent pas à ceux du Canada.
Joseph Howe réussit à convaincre l’électorat. Lors des élections du 18 septembre 1867 en Nouvelle-Écosse, le Parti anti-Confédération de Joseph Howe remporte 36 des 38 sièges.
Mais cela ne change rien. Charles Tupper, premier ministre jusqu’en septembre 1867, croit que le fait de se joindre au Canada renforcerait le secteur commercial de la Nouvelle-Écosse, offrirait une plus importante influence à la colonie, et préviendrait l’annexion par les États-Unis. Il utilise la majorité de son gouvernement à la législature coloniale pour adopter les conditions de la Confédération tel que convenu à Québec (voir Résolutions de Québec).
Mais le sentiment public n’est pas de son côté. Au bord de l’eau de la ville de Halifax, les protestataires brûlent l’effigie de Charles Tupper, avec un rat vivant. Dans la ville de Yarmouth, certains bâtiments sont drapés de tissu noir en guise de protestation. Le lendemain matin de la naissance du Canada, le Morning Chronicle déplore : « Morte ! Hier soir à minuit, la province libre et éclairée de la Nouvelle-Écosse ! »
Un autre journal local, The British Colonist, applaudit la Confédération et la fin des « jours d’isolement et d’infériorité ».
Les Néo-Écossais n’auront jamais la chance de voter sur la Confédération. Ils se font à nouveau clairement entendre lors de la première élection canadienne, le 18 septembre 1867. Sur les 19 sièges de la province à Ottawa, 18 sont attribués au Parti anti-Confédération de Joseph Howe.
Encouragé par ces résultats, Joseph Howe mène une lutte de deux ans pour l’abrogation de l’union (voir Mouvement sécessionniste). Lorsque cet espoir disparaît, il s’efforce d’améliorer les conditions de la Nouvelle-Écosse. D’une manière très canadienne, Joseph Howe, tout comme Antoine-Aimé Dorion, accepte sa défaite. Il rejoint le gouvernement fédéral en 1869. En 1873, il devient lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse. Il meurt trois semaines plus tard.
(Voir aussi La Nouvelle-Écosse et la Confédération.)

La résistance de l’Île-du-Prince-Édouard
En 1864, l’Île-du-Prince-Édouard accueille la Conférence de Charlottetown, où le plan de la Confédération voit le jour. Cependant, la colonie décide de ne pas se joindre au nouveau pays.
Edward Palmer, premier ministre de 1859 à 1863, rejette la Confédération. Comme le mouvement anti-Confédération de la Nouvelle-Écosse de Joseph Howe, Edward Palmer croit que l’adhésion au Canada diminuerait les pouvoirs de sa province. Il s’oppose même à une union avec les autres colonies des Maritimes ; il croit que cela ne serait bénéfique qu’au gouvernement britannique, et non pas à l’Île-du-Prince-Édouard.
« Nous remettrions nos droits et notre prospérité, dans une certaine mesure, entre les mains du gouvernement général, et notre voix à un parlement uni serait très négligeable », soutient-il.
James Pope est initialement plus ouvert à la Confédération. Il déclare qu’il approuve « le principe abstrait de l’union proposée », mais il ne peut se résoudre à accepter les réelles conditions offertes. Il est d’avis qu’elles sont injustes pour les habitants de l’île.
James Pope est un homme d’affaires et un membre de l’Assemblée législative de l’île depuis 1863. Il est né en Angleterre et a immigré à l’Île-du-Prince-Édouard en 1819. Malgré son scepticisme, lorsque le débat sur la Confédération dégénère en conflits colériques publics, James Pope décide d’appuyer un politicien de l’Î.-P.-É. en faveur de la Confédération, John Hamilton Gray.

Edward Palmer est à la tête du camp anti-Confédération. Mais la faction de l’assemblée dirigée par John Hamilton Gray l’évince toutefois du bureau en 1863, et le remplace par John Hamilton Gray.
James Pope devient premier ministre en 1865. En 1866, il présente la « Résolution sans conditions » à l’assemblée. La résolution rejette les conditions d’entrée dans la Confédération stipulées à la Conférence de Québec et garantit que l’Î.-P.-É. ne s’y joindra pas.
L’opposition de James Pope et d’Edward Palmer à la Confédération est représentative de l’humeur du public. Edward Palmer collabore avec des mouvements anti-Confédération en Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick. Il veut également améliorer le meilleur accord commercial de la colonie avec les États-Unis. Les deux autres provinces maritimes se joignent à la Confédération, mais l’Î.-P.-É. reste à l’écart.
En 1871, l’Î.-P.-É. amorce la construction d’un chemin de fer afin de développer l’économie de la province. Mais cela détruit presque l’économie. Le gouvernement croule sous les dettes et fait face à un effondrement économique en 1873. Edward Palmer avait prévenu d’un tel résultat dès le début, mais avait soutenu le projet de chemin de fer par nécessité politique.
James Pope se présente à nouveau aux élections de cette année-là, mais avec une promesse très différente ; celle de faire entrer l’Î.-P.-É. dans la Confédération. C’est avec le cœur lourd qu’Edward Palmer adopte également une position pro-Confédération.
James Pope remporte les élections et est donc premier ministre de l’Î.-P.-É. lorsque la province se joint au Canada en 1873. Edward Palmer quitte la politique et retourne au droit. Il occupe le poste de juge en chef jusqu’à sa mort en 1889.
Les sentiments anti-Confédération à l’Île-du-Prince-Édouard refont brièvement surface en 1973, lorsque l’île célèbre officiellement le 100e anniversaire de son union avec le Canada. Une poignée d’étudiants activistes ont conquis le cœur de nombreux habitants de l’île avec une campagne qui dure un an et pendant laquelle ils font toutes sortes de canulars pour se moquer de la Confédération. Ils drapent les portes de l’Assemblée législative de tissu noir, et installent une toilette extérieure sur le terrain de la Province House à titre de faux bureaux de scrutin ; le public est invité à entrer et à voter sur le maintien de l’Î.-P.-É. au sein du Canada.
(Voir aussi L’Île-du-Prince-Édouard et la Confédération.)

La Résistance du Nord-Ouest
Les opposants à la Confédération dans l’est du Canada trouvent des motifs économiques somme toute modérés pour ne pas se joindre au Canada. Mais les motivations sont bien différentes dans l’ouest.
Après la Confédération, le Canada étend sa portée en achetant le vaste territoire de la Terre de Rupert à la Compagnie de la Baie d’Hudson en 1870 (voir aussi Territoires du Nord-Ouest).
En 1885, ces ambitions se heurtent à une violente résistance connue sous le nom de Résistance du Nord-Ouest. La révolte de cinq mois est menée par les Métis, les Cris, les Siksika, les Kainai, les Piikani, et les Saulteaux. Elle commence lorsque l’expansion canadienne sur leurs terres pousse les Premières Nations vers la famine. En 1880, le chef des Cris Big Bear et le chef des Pieds-Noirs Crowfoot fondent la Confédération des Pieds-Noirs. En 1884, Louis Riel, un leader métis de la Résistance de la rivière Rouge, cherche à unir les peuples du Nord-Ouest contre le gouvernement canadien.
En 1885, les partisans de Louis Riel adoptent une déclaration révolutionnaire des droits. Elle exige des revendications territoriales pour les Métis et fait des demandes au gouvernement canadien. En mars de cette année-là, des résistants armés forment un gouvernement provisoire et nomment Louis Riel comme président. Les forces menées par les Métis occupent Duck Lake près de Batoche, dans la Saskatchewan d’aujourd’hui. Le 26 mars, 100 agents de la Police à cheval du Nord-Ouest (P.C.N.-O.) et des citoyens bénévoles se rendent à Duck Lake. La résistance métisse et autochtone rencontre la police à l’extérieur du village. Dans l’affrontement, douze agents de la P.C.N.-O. et six combattants de la résistance sont tués.

Le gouvernement canadien envoie 3 000 soldats en renfort aux 2 000 qui sont déjà stationnés dans l’Ouest. Ils se heurtent à une résistance acharnée telle que celle de Big Bear. Il s’oppose aux plans du Canada de déplacer son peuple dans une réserve. Ses guerriers lancent des attaques de petite envergure contre les prêtres, contre un agent des affaires indiennes, et contre un commerçant, tuant ainsi plusieurs personnes. Les deux parties s’affrontent à nouveau à la bataille de Batoche, où le chef cri Poundmaker mène les forces autochtones à la victoire.
Les forces canadiennes continuent et capturent Batoche en mai. Le 15 mai, Louis Riel se rend. Le dernier acte de la résistance se joue le 3 juin au lac Loon, par une petite escarmouche entre les deux camps. Le 26 mai, Poundmaker et d’autres dirigeants autochtones se rendent aux troupes canadiennes. Louis Riel est exécuté le 16 novembre 1885, suivi par le chef cri Wandering Spirit, le 27 novembre. Ainsi se termine la Résistance du Nord-Ouest.

L’opposition à la Confédération de la part des peuples autochtones se poursuit jusqu’à ce jour. La Crise d’Oka en 1990 est déclenchée par des militants mohawks qui pressent le Canada à reconnaître leurs droits à la terre dont ils bénéficiaient avant la Confédération. Les traités numérotés de l’Ouest conduisent également à des batailles juridiques. Hayden King, le directeur du Centre of Indigenous Governance de l’Université Ryerson, fait valoir que les Premières Nations considèrent ces traités comme des accords de partage, tandis que le Canada les considère comme des cessions de terres.
Bon nombre de ces différends sont réglés par la Cour suprême du Canada ; par exemple, son jugement de 2014 confirmant la revendication territoriale de la Nation des Chilcotins sur l’intérieur de la Colombie-Britannique. Alors que les luttes juridiques se poursuivent, de nouveaux territoires comme le Nunavut démontrent que les Premières Nations peuvent obtenir une plus grande autonomie locale et régionale au sein de la Confédération.
(Voir aussi Autonomie gouvernementale des Autochtones; Le Manitoba et la Confédération; La Saskatchewan et la Confédération.)
Terre-Neuve-et-Labrador
Terre-Neuve est le dernier territoire britannique d’Amérique du Nord à se joindre à la Confédération.
La colonie envoie des délégués à la Conférence de Québec de 1864. Mais des dirigeants anti-Confédération comme Charles Fox Bennetts s’opposent toutefois à toute union. Il est d’avis que cela conférerait une influence indue du Québec sur Terre-Neuve, et entraînerait une hausse des impôts ainsi que la conscription militaire.
De même, les catholiques et les commerçants s’opposent à l’adhésion au Canada. De nombreux catholiques sont originaires d’Irlande. Ceux-ci estiment que l’Irlande doit la plupart de ses problèmes à la domination britannique. À Terre-Neuve, les Irlandais ont déjà une certaine autonomie politique, des écoles séparées financées par l’État et d’autres avantages pour lesquels leurs cousins d’Irlande se battent toujours. Pourquoi s’unir au Canada et ainsi risquer de perdre ces droits acquis ?
Les commerçants ne voient aucun avantage économique à la Confédération. En fait, ils s’attendent à une hausse des impôts et des tarifs qui nuirait à Terre-Neuve. La chanson populaire « The Anti-Confederation Song » (chanson anti-confédération) met en garde, « Approche-toi à tes risques et périls, loup canadien ». Une expression populaire déclare : « Terre-Neuve pour les Terre-Neuviens » et elle exhorte les habitants à « tenez-vous-en à votre mère patrie, Grande-Bretagne ».
Deux ans après la Confédération, l’élection de 1869 est remportée massivement par les opposants de l’union. Terre-Neuve demeure à l’extérieur du Canada.

La colonie commence les années 1900 en grande forme. La Première Guerre mondiale apporte la prospérité économique. Le gouvernement dépense de l’argent pour construire des chemins de fer et des autoroutes. Mais à la fin de la guerre, Terre-Neuve fait face à une dette de 43 millions de dollars. Dans les années 1930, la dette de la colonie est d’environ100 millions de dollars. Confronté à de graves problèmes financiers, le gouvernement se tourne vers la Grande-Bretagne pour obtenir de l’aide. La Grande-Bretagne recommande de suspendre le gouvernement responsable et de confier la gestion de la colonie à une commission désignée. Ceci signifie que le Parlement britannique prendra les décisions pour Terre-Neuve. La Commission de gouvernement prend donc le relais en 1934.
La colonie prospère de nouveau pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle devient une importante base de l’Atlantique Nord pour les forces alliées (voir Gander). Après la guerre, les Terre-Neuviens votent sur l’une des trois options pour leur avenir : la commission de gouvernement, l’autonomie gouvernementale, ou la Confédération. Après deux référendums, les partisans de la Confédération remportent une victoire serrée (52 % des voix). Joey Smallwood mène la colonie à l’union avec le Canada en avril 1949.
Depuis, des feux nationalistes mijotent à Terre-Neuve. En 2008, Ryan Cleary, rédacteur en chef du journal The Independent de St. John’s, écrit : « Maintenant que nous roulons sur l’or, il est peut-être temps d’envisager notre rupture du Canada ». Quatre ans plus tard, l’auteur et animateur de Terre-Neuve Greg Malone fait valoir dans son livre intitulé Don’t Tell the Newfoundlanders : The true story of Newfoundland’s Confederation with Canada que le vote de 1948 en vue de l’union au Canada a été illégalement truqué dans le cadre d’une conspiration orchestrée par Ottawa et la Grande-Bretagne. L’œuvre est un succès de librairie à Terre-Neuve.
(Voir aussi Terre-Neuve-et-Labrador et la Confédération; Projet de loi de Terre-Neuve; Éditorial : Comment la communauté « canadiennisée » de la Terre Neuve s’est jointe au Canada.)

Le FLQ au Québec
L’opposition la plus violente et la plus moderne envers la Confédération se manifeste au sein de l’une des provinces fondatrices, 100 ans après la formation du pays. Dans les années 1960, des radicaux du Québec forment des partis comme le Réseau de Résistance du Québécois et Le Comité français de Libération nationale. Les membres les plus radicaux des deux groupes s’unissent et forment le Front de libération du Québec (FLQ).
Les Québécois Raymond Villeneuve et Gabriel Hudon, en compagnie du Belge Georges Schoeters, fondent le FLQ en 1963. Ils s’inspirent des révolutionnaires anticoloniaux de l’époque de Cuba et de l’Algérie. Le FLQ emprunte également des images et des idées des Patriotes (ou parti canadien), qui ont combattu lors de la rébellion de 1837-1838 dans le Bas-Canada (voir aussi Rébellions de 1837–1838). Le FLQ souhaite créer un État indépendant. Ses membres croient que cela donnerait aux Québécois plus de contrôle sur leur vie, ainsi que de meilleures conditions économiques.

Les membres du FLQ se lancent dans une campagne de terreur. Ils posent des bombes dans les boîtes aux lettres du quartier prospère de Westmount à Montréal, pour détruire les symboles du colonialisme anglais. Ils bombardent et vandalisent les édifices du gouvernement. En 1964, ils volent de l’argent et du matériel militaire à la société International Firearms ; l’un des membres tue le vice-président de la compagnie. Les attaques s’intensifient tout au long des années 1960 et atteignent leur apogée avec la crise d’octobre de 1970.
Le FLQ kidnappe deux fonctionnaires du gouvernement : le délégué commercial britannique James Cross, puis le ministre provincial Pierre Laporte. Ils tuent ce dernier le 17 octobre 1970. Le gouvernement fédéral de Pierre Elliot Trudeau invoque la Loi sur les mesures de guerre. C’est la seule fois dans toute l’histoire du Canada que la Loi est utilisée en temps de paix. Le gouvernement fédéral déclare que l’appartenance au FLQ est un acte criminel. Les troupes armées descendent dans les rues. Plus de 450 personnes sont arrêtées.
Le FLQ s’éteint. Mais au Québec, le désir d’indépendance demeure, et grandit paisiblement.
Le référendum de Québec de 1980
En 1976, les Québécois élisent le Parti québécois, qui a pour objectif principal la séparation du Canada (voir Souveraineté-association). Sous le premier ministre René Lévesque, le PQ fait du français la seule langue officielle du Québec. Il fait également la promesse de mettre en œuvre un référendum sur la souveraineté-association lors de son premier mandat.
Le 21 juin 1979, les conditions favorables sont enfin réunies pour l’annonce de la date de la tenue du référendum : les libéraux dirigés par Pierre Elliott Trudeau viennent de perdre les élections générales fédérales du 22 mai. René Lévesque a désormais pour vis-à-vis Joe Clark, un premier ministre qui a peu d’influence au Québec et qui est à la tête d’un gouvernement minoritaire. Il est entendu que le référendum se tiendra au printemps 1980. Celui-ci se tient le 20 mai 1980 et invite la population québécoise à se prononcer sur le mandat de négocier, d’égal à égal, un nouvel accord constitutionnel avec le reste du Canada.
Au début de décembre, le calcul politique change à nouveau. Le gouvernement dirigé par Joe Clark perd un vote de confiance sur l’adoption de son premier budget. De nouvelles élections sont fixées au 18 février 1980. Cette fois, les libéraux l’emportent, avec 74 circonscriptions sur 75 au Québec. Pierre Elliott Trudeau, qui reprend la tête du parti, dirige désormais un gouvernement majoritaire (voir aussi Élections de 1979 et 1980). Il promet alors que son gouvernement réformera le fédéralisme et qu’un vote pour le non n’est pas un vote pour le statu quo.
Lors du référendum du 20 mai 1980, le « oui » est rejeté par 59,56 % des voix. Le taux de participation est de 85,61 %. Après cette défaite, le Parti québécois considère toujours que la souveraineté demeure la seule option viable pour le Québec et qu’elle gagnera un jour un appui majoritaire. Cet espoir est déjà palpable dans le discours de René Lévesque le soir du 20 mai 1980 alors qu’il déclare « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de nous dire à la prochaine fois ».

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom